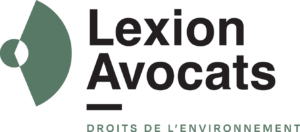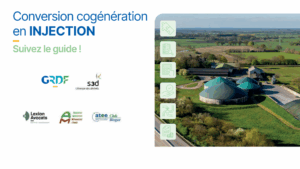Tribunal administratif de Marseille, 3ème Chambre, 17 janvier 2025, 2309086
Par Maître Vladimir Estène, avocat, LEXION AVOCATS
- Le cadre général : le recours en contestation de la validité d’un contrat administratif
Dans le célèbre arrêt de principe Département de Tarn-et-Garonne (CE, 4 avril 2014, req. n° 358994, publié au recueil Lebon), le Conseil d’Etat a unifié le recours des tiers en contestation de la validité d’un contrat administratif :
« Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ;
[…]
Considérant que le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. »
Si tout tiers est ainsi fondé à former un tel recours, les moyens susceptibles d’être invoqués diffèrent selon que le requérant est le Préfet ou un membre de l’organe délibérant d’une part, ou un autre tiers, en ce compris les concurrents évincés, d’autre part.
Lorsque le juge constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, il lui appartient d’en apprécier l’importance et les conséquences :
« Qu’ainsi il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu’en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu’il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés. »
- Le cadre spécifique : la procédure d’attribution d’une DSP
La procédure d’attribution d’une convention de délégation de service public (DSP) repose sur le respect des dispositions du code de la commande publique (CCP) et du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Il ressort en particulier des dispositions des articles L.1411-4 et L.1411-5 du CGCT que :
- L’assemblée délibérante doit avant le lancement d’une procédure visant à l’attribution d’une DSP se prononcer sur le principe du recours à un tel contrat ;
- L’autorité habilitée à signer la convention peut négocier avec les soumissionnaires au vu de l’avis de la commission de délégation de service public (CDSP) ;
- Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé et lui transmet le rapport de la CDSP présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat.
Le tribunal administratif de Marseille rappelle qu’il résulte de ces dispositions que :
« Le maire ne peut, au nom de la commune, valablement souscrire avec un opérateur économique une convention de délégation de service public, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. Ainsi, lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de son attributaire. »
- L’application en l’espèce
La commune d’Eyguières avait conclu une DSP avec la société d’exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d’Eyguières (SEZAME).
Le contrat en question avait pour objet « la gestion et l’exploitation de l’ensemble du site unique de l’aérodrome de Salon-Eyguières », comprenant une zone dédiée à l’aérodrome et une zone dédiée aux sports mécaniques.
Il avait confié au concessionnaire à la fois l’exploitation de l’aérodrome et de la zone dédiée aux sports mécaniques pour une durée de 25 ans et la réalisation de travaux sur les deux sites.
Une conseillère municipale avait formé un recours en contestation de la validité du contrat visant à ce que le tribunal administratif de Marseille procède à l’annulation de cette convention de DSP.
La conseillère municipale soutient notamment que la DSP signée est illégale dès lors qu’elle présente des modifications substantielles par rapport au projet de contrat soumis à l’approbation du conseil municipal.
Le tribunal administratif de Marseille les a relevées dans son jugement :
- L’article du contrat relatif à la sous-traitance et au partenariat mentionne six prestataires sous-traitants non mentionnés dans le projet initial ;
- L’article du contrat relatif aux modalités de financement du projet ne mentionne plus le montant des emprunts bancaires pour répondre aux besoins de financement du projet ni les organismes auxquels il sera fait appel ;
- Ce même article stipule que « le présent contrat est donc conclu, s’agissant de la réalisation des travaux, sous condition suspensive » d’obtention des prêts bancaires et des subventions alors que le projet initial prévoyait que l’exécution du contrat, et non seulement la partie relative aux travaux, était subordonnée à l’obtention de prêts et de subventions ;
- Ce même article prévoit la possibilité de poursuivre le contrat même en l’absence de réalisation de la condition suspension d’obtention des prêts et subventions, laquelle pourrait être neutralisée, alors que le projet initial ne prévoyait pas une telle hypothèse ;
- L’article relatif aux recettes tirées de l’exploitation du service précise que les « recettes prévisionnelles issues du photovoltaïque contribuent significativement à l’équilibre général du Contrat », ce qui ne figurait pas dans le projet initial ;
- Ce même article ne fait plus référence à la condition d’obtention des autorisations nécessaires pour la signature des contrats relatifs à l’énergie photovoltaïque et la conclusion du contrat de concession prévu dans le projet initial ;
- Le contrat final introduit deux nouvelles conditions susceptibles de modifier l’équilibre du contrat, à savoir l’absence de désignation en tant que lauréat des appels d’offres organisés par la Commission de Régulation de l’Énergie et l’absence de mise en service des centrales photovoltaïques, et aménage les effets d’une absence de réalisation de ces conditions ;
- Le contrat introduit un article relatif à la « cession du contrat par le concessionnaire », alors qu’une telle cession n’est possible que sous réserve de l’accord de la personne publique.
Dans ces conditions, le tribunal administratif juge que le contrat signé présentait des modifications substantielles par rapport au projet initial soumis au conseil municipal, tenant en particulier aux dispositions financières du contrat.
Il s’en infère que le conseil municipal n’a pas eu connaissance de l’ensemble des éléments essentiels du contrat finalement signé.
En procédant à la signature du contrat, le maire a ainsi méconnu l’étendue de la compétence du conseil municipal.
Partant, le tribunal administratif en déduit que le contrat est entaché d’un vice du consentement de la commune.
Le vice constaté étant d’une particulière gravité, en ce qu’il affecte les conditions dans lesquelles l’autorité délégante a donné son consentement, qui ne peut être régularisé et ne permet pas la poursuite de l’exécution du contrat, et en l’absence de toute circonstance permettant d’estimer que le conseil municipal a ensuite donné son accord à la conclusion du contrat, le tribunal administratif juge qu’il y a lieu d’annuler la DSP, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette annulation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Ce jugement permet donc de rappeler avec force que le projet de contrat soumis à l’organe délibérant doit être finalisé.
Le conseil municipal doit en effet pouvoir se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de son attributaire.
En aucun cas des modifications substantielles ne doivent ainsi intervenir postérieurement à l’approbation du contrat par l’organe délibérant, puisque le calendrier procédural à respecter est le suivant :
- La négociation intervient avant l’analyse des offres finales d’une part ;
- La mise au point intervient avec le titulaire pressenti avant la finalisation du contrat soumis à l’organe délibérant d’autre part.
Par Maître Vladimir Estène