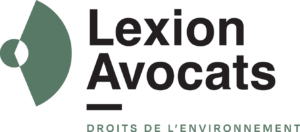Par Stéphanie Gandet – avocate associée, spécialisée en droit de l’environnement
Et Clara Scarabotto – élève avocate – Lexion Avocats
Après un parcours parlementaire tumultueux, la Loi n°2025-794 du lundi 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur a été publiée au Journal officiel du 12 août dernier.
Beaucoup d’articles ont été publiés au sujet de la censure, mais les dispositions maintenues (et non contestées) sont restées plus dans l’ombre… alors qu’elles méritent incontestablement l’intérêt des praticiens du droit de l’environnement, du monde agricole et des acteurs publics.
- Le contrôle de constitutionnalité de la Loi Duplomb
Cette loi a bénéficié d’une couverture médiatique importante, notamment due à la pétition contre l’adoption de cette loi sur le site de l’Assemblée nationale ayant recueilli plus de 2 millions de signatures.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi à trois reprises, en application de l’article 61 de la Constitution, les 11, 15 et 18 juillet derniers, par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs, afin d’en contrôler la constitutionnalité.
Par une décision n°2025-891 du 7 août 2025, le Conseil a censuré partiellement l’article 2 de la loi qui avait permis, sous certaines conditions, de déroger par décret à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits.
Le raisonnement ayant conduit à la censure de l’article 2 précité mérite d’être analysé.
Nous examinerons ensuite les différentes modifications législatives qui n’ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel :
- le régime des installations d’élevage relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (article 3)
- la présomption instituée au profit des ouvrages de stockages d’eau à finalité agricole (article 5).
- Objet et portée de la censure partielle de l’article 2 de la loi (néonicotinoïdes)
Il était projeté de modifier l’article L. 253-8 du code rural et de la pèche maritime afin de permettre l’instauration, par décret, d’une dérogation à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits.
Selon la loi, cette dérogation était possible, à titre exceptionnel, pour faire face à une menace grave compromettant la production agricole, après l’avis public d’un conseil de surveillance, et sous conditions :
- que les alternatives soient inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
- et qu’il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
La dérogation était encadrée de la manière suivante :
- le bien-fondé du décret devait être réévalué tous les 3 ans, et chaque année après cette période. La dérogation devrait être abrogée dès que l’une des conditions nécessaires à celle-ci ne serait plus réunie.
- une interdiction temporaire de plantation de plantes attractives d’insectes pollinisateurs pour les cultures non pérennes, après l’emploi des produits, pouvait être actée par arrêté ministériel
- un rapport devait être remis annuellement par le conseil de surveillance au Gouvernement et au Parlement afin de décrire les conséquences et indiquer l’avancement du plan de recherche.
Le Conseil constitutionnel, en ses considérants 79 à 83, a toutefois estimé que :
- 1° les produits en cause ont une incidence sur la biodiversité (en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux,), et sur la qualité de l’eau et des sols
- 2° les produits en cause induisent des risques pour la santé humaine
- 3° la dérogation prévue peut être accordée à toutes les filières agricoles, sans identification précise de la filière sur laquelle pèse une menace particulière dont la gravité compromettrait la production agricole
- 3° la dérogation n’est pas accordée, à titre transitoire, pour une période déterminée, elle devait seulement faire l’objet d’une réévaluation par le conseil de surveillance, sans limitation dans la durée
- 4° que la dérogation peut être mobilisée pour tout type d’usage et de traitement, y compris ceux qui, recourant à la pulvérisation, présentent des risques élevés de dispersion des substances
Dès lors, le Conseil a considéré que cette dérogation ne comporte pas suffisamment de garanties permettant d’assurer le droit de vivre dans un environnement sain, consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement.
Toutefois, la loi créé un nouvel article au sein du code (L.253-1A du code rural) établissant, en cas d’interdiction d’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant une substance autorisée par les instances européennes, une obligation pour l’État :
- d’une part, d’accompagner les professionnels dans la recherche et la diffusion de solution alternative,
- et d’autre part, d’indemniser les exploitants subissant des pertes d’exploitations significatives tant qu’une alternative est inexistante ou manifestement insuffisante
Une solution alternative est définie comme étant une solution technique fiable permettant une protection semblable à celle obtenue par le produit interdit et financièrement acceptable par rapport au produit interdit.
Décryptage de l’article 3 de la loi relatif à la procédure ICPE applicable à certaines catégories d’élevages
L’article 3 de la loi procède à une modification des dispositions du régime ICPE (« installations classées pour l’environnement ») pour certaines catégories d’activités d’élevage.
- Sur la consultation du public pour certaines installations d’élevage soumises à autorisation
Premièrement, cet article a opéré une modification de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement relatif au déroulement de la consultation du public, créé par la loi Industrie Verte.
Pour les activités d’élevage de porcs, bovins ou de volailles relevant du régime de l’autorisation environnementale, la loi permet le remplacement des deux réunions publiques de la consultation du public (organisée dans les 15 premiers et derniers jours de la consultation), par une permanence organisée par le commissaire enquêteur.
La tenue d’une réunion publique sera néanmoins possible à la demande du pétitionnaire.
Gageons que vu le caractère généralement peu constructif de ce type de réunions, qui s’apparentent souvent à un dialogue de sourds voire à des invectives, les porteurs de projets ne choisissent pas cette option de la réunion publique.
De plus, les réponses aux avis mis en ligne, aux propositions et observations du public sont désormais facultatives.
Le pétitionnaire a seulement pour obligation de répondre à l’avis de la MRAE (mission régionale de l’autorité environnementale rendant un avis pour l’évaluation environnementale du projet).
Les auteurs des saisines du Conseil constitutionnel avaient critiqué le fait que ces dispositions méconnaissent selon eux le principe d’égalité devant la loi et l’article 7 de la Charte de l’environnement relatif au droit à l’information et à la participation du public aux décisions ayant une incidence environnementale.
Sur le principe d’égalité devant la loi, le Conseil a toutefois considéré que cette différence de traitement ne méconnaissait pas le principe d’égalité de la loi pour les raisons suivantes :
- il est loisible au législateur de considérer que certaines installations d’élevage se distinguaient des autres exploitations
- et cette différence de traitement est justifiée pour un motif d’intérêt général de simplification administrative visant à corriger des exigences excédant les exigences du droit de l’Union européenne
Le Conseil constitutionnel en a déduit que la différence de traitement instituée par ces dispositions, qui est fondée sur une différence de situation, est bien en rapport avec l’objet de la loi.
S’agissant de l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil a jugé que :
- le pétitionnaire et l’autorité administrative doit néanmoins prendre en considération les avis et les observations du public parvenus pendant la durée de la consultation, même si la réponse du pétitionnaire est facultative ;
- les dispositions contestées, qui se bornent à remplacer les réunions publiques d’ouverture et de clôture de la consultation du public par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, ne modifient pas les dispositions législatives assurant la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause.
Dès lors, la modification que la Loi « Duplomb » a apportée à l’article L.181-10 du code de l’environnement a été validée par le Conseil constitutionnel.
- Sur le classement en enregistrement de certaines installations d’élevage classé IED
Deuxièmement, l’article L.512-7 du code de l’environnement est modifié afin d’inclure la possibilité d’un classement en régime d’enregistrement de certaines installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive IED (relative aux émissions industrielles et émissions d’élevage).
La loi a exclu les élevages intensifs qui sont mentionnés dans la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement.
Le Conseil a considéré que :
- cette disposition n’avait pas pour effet de modifier les obligations légales opposables aux installations relevant de l’enregistrement, et n’était pas, de ce fait, contraire à l’article 1er et 2 de la Charte de l’environnement.
- le régime des installations relevant de l’enregistrement demeure soumis à une procédure de participation du public, et, de ce fait, n’était pas contraire à l’article 7 de la Charte précédemment cité.
Dès lors, la modification que la Loi « Duplomb » a apportée à l’article L.512-7 du code de l’environnement a été déclarée conforme à la Constitution.
Décryptage de l’article 5 de la loi relatif aux ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements d’eau associés (présumés d’intérêt public majeur)
L’article 5 de la loi a modifié l’article L. 211-1 du code de l’environnement en intégrant, dans les principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la préservation de l’accès à la ressource en eaux à des fins d’abreuvement des animaux d’élevage.
Cette disposition n’a pas été critiquée devant le Conseil constitutionnel.
La loi a également inséré un nouvel article L. 211-1-2 au sein du code de l’environnement, afin de prévoir que certains ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux associés sont présumés « d’intérêt général majeur ».
En corollaire, un nouvel article L. 411-2-2 a été créé au sein du code de l’environnement prévoyant que ces mêmes ouvrages et prélèvements sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats.
En d’autres termes, la loi a intégré une double présomption, pour que les ouvrages de stockages d’eau et les prélèvements d’eau superficielle ou souterraines à finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif compromettant la production agricole, soient considérés :
- D’une part, « d’intérêt général majeur », par la création d’un nouvel l’article L. 211-1-2 du code de l’environnement afin de permettre une dérogation aux objectifs de bon état de qualité des eaux ;
- Et, d’autre part, « d’intérêt public majeur », par la création de l’article L.411-2-2 du code de l’environnement, qui est l’une des trois conditions nécessaires à la délivrance d’une dérogation à l’interdiction de destruction ou perturbation d’espèce ou d’habitat protégée.
Les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel arguaient du fait que ces dispositions méconnaîtraient les exigences découlant de l’article 1er de la Charte de l’environnement, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Le Conseil constitutionnel a toutefois validé ces dispositions en considérant :
- d’une part, que si les dispositions contestées s’appliquent à des prélèvements sur les eaux souterraines, elles ne sauraient, sans méconnaître le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, être interprétées comme permettant la réalisation de tels prélèvements au sein de nappes inertielles, signifiant celles ayant une fréquence de remplissage pluriannuelle (considérant n°137 de la décision) ;
- et d’autre part, que sauf à méconnaître ces mêmes exigences, les présomptions instituées par ces dispositions ne sauraient être regardées comme revêtant un caractère irréfragable faisant obstacle à la contestation de l’intérêt général majeur ou de la raison impérative d’intérêt public majeur du projet d’ouvrage concerné en cas de contentieux contre les autorisations (considérant n°138 de la décision).
En d’autres termes, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de l’article 5 de la loi sur les ouvrages de stockage d’eau sous les deux réserves suivantes :
- les présomptions instaurées par ces dispositions ne peuvent pas concerner des prélèvements au sein de nappes inertielles ; et la présomption ne peut revêtir un caractère irréfragable, signifiant qu’il doit être possible de renverser la préemption.
- Décryptage de l’article 6 relatif aux modalités des contrôles réalisés par les inspecteurs de l’environnement, dont les agents de l’OFB
Le texte sur lequel un accord a été acté par la Commission Mixte Paritaire et voté, in fine, par le Parlement, modifie substantiellement la disposition initialement envisagée.
La loi modifie le IV de l’article L.131-9 du code de l’environnement et permet au préfet de département, dans le cadre de sa mission de délégué territorial de l’OFB, d’assurer la cohérence de l’exercice des missions de police administrative de l’eau et de l’environnement « notamment en approuvant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions. »
Il ne sera dès lors possible pour le préfet de département que d’acter une programmation annuelle des contrôles réalisés par les inspecteurs de l’environnement, dont les agents de l’OFB et non (comme c’était prévu initialement) « d’inviter » les agents de l’OFB à privilégier une sanction plutôt qu’une autre.
Deuxièmement, l’article 6 de la loi a créé l’article L.174-3 du code de l’environnement visant à permettre le recours à l’usage de caméras permettant un enregistrement des interventions des inspecteurs de l’environnement lorsqu’il existe un risque d’incident au regard des circonstances ou au comportement de la personne concernée.
Ces dispositions répondent à un sentiment qui pouvait incontestablement exister au sein de la filière agricole, d’une forme de disproportion entre la gravite et l’impact psychologique de poursuites pénales et les faits reprochés, souvent involontaires et qui peuvent s’inscrire dans une exploitation agricole classique … mais qui se heurte à une volonté plus forte, et légitime, de protection de certains milieux (haies par exemple).
Par Stéphanie Gandet – avocate associée, spécialisée en droit de l’environnement
Et Clara Scarabotto – élève avocate – Lexion Avocats