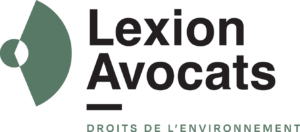CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-Mer, req. n° 503317 : publié au Rec. CE.
Par Maître Vladimir Estène, avocat, LEXION AVOCATS
Par une importante décision rendue le 17 juillet 2025, le Conseil d’Etat juge que les règles relatives aux biens dits « de retour » peuvent, dans certaines hypothèses particulières, trouver à s’appliquer aux biens qui sont la propriété d’un tiers au contrat de concession.
Le caractère attractif de cette notion se voit ainsi renforcé.
Pour rappel, les règles applicables aux biens d’une concession ont été posées de façon nette dans l’arrêt Commune de Douai (CE, 21 décembre 2012, req. n° 342788), qui a notamment permis de mieux distinguer :
- Les « biens de retour » : les biens nécessaires au fonctionnement du service public créés ou acquis à la suite d’investissements du concessionnaire appartiennent, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ;
- Les « biens de reprise » : les parties peuvent convenir d’une faculté de reprise par la personne publique, à l’expiration de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service ;
- Les « biens propres » : les biens qui n’ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n’en disposent autrement.
Cette notion de « biens de retour » est fondamentale, puisqu’elle a pour objet de préserver le patrimoine des autorités concédantes d’une part, et d’assurer un retour « gratuit » en fin de concession desdits biens, du moins lorsqu’ils ont été amortis au cours de l’exécution du contrat :
« A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. »
Très logiquement, en application de ces principes, le concessionnaire est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis à la suite de d’une résiliation anticipée de la concession.
Partant d’une logique parfaitement fondée de protection du patrimoine et des finances des autorités concédantes, la théorie des « biens de retour » s’est progressivement muée en un vecteur d’incorporation de biens toujours plus nombreux.
En premier lieu, il a été jugé que les règles énoncées supra trouvaient également à s’appliquer lorsque le concessionnaire était, antérieurement à la passation de la concession, propriétaire de biens qu’il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci (CE, 29 juin 2018, ministre de l’Intérieur, req. n° 402251).
Cette solution a pu apparaitre contestable car n’était alors pas visé le moindre investissement correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, qui définissent pourtant les « biens de retour ».
En second lieu, ce sont dorénavant les tiers à la convention de concession qui peuvent désormais se voir appliquer la théorie des « biens de retour » :
- Les règles énoncées ci-dessus ne trouvent en principe pas à s’appliquer aux biens qui sont la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils seraient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci ;
- Il en va différemment dans le cas où :
- D’une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l’un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre ou de regarder l’un et l’autre comme étant placé sous le contrôle d’une même entreprise tierce ;
- Et, d’autre part, le bien, exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution ;
- Dans un tel cas, le propriétaire du bien doit être regardé comme ayant consenti à ce que l’affectation du bien au fonctionnement du service public emporte son transfert dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions précédemment énoncées.
C’est l’objet de l’arrêt commenté, dans une affaire concernant une concession conclue pour l’installation et l’exploitation de jeux de casino, et dont il ressort que :
- Le bâtiment abritant actuellement le casino était la propriété de la société Groupe Partouche, qui l’avait acquis auprès de la commune en vue de l’aménager pour pouvoir exploiter le futur casino et qui le louait à la société Jean Metz, société concessionnaire dont elle détenait l’intégralité du capital, par l’effet d’un bail commercial dont les stipulations prévoyaient expressément que l’activité exercée dans le bâtiment est l’exploitation d’un casino et des services associés ;
- Dans ces conditions, la circonstance que le bâtiment du casino n’était pas la propriété du concessionnaire ne faisait pas obstacle à ce qu’il revienne à la commune au terme de la convention.
En somme, les montages par lesquels une société-mère prend en charge les investissements de la concession et détient la propriété des biens destinés à l’exécution de la concession, au détriment de la société concessionnaire, ne permettent pas de faire échec à l’application des règles portant sur les « biens de retour ».
Par Me Vladimir Estène