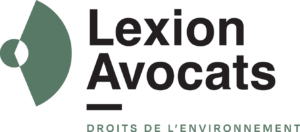Décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025
Par Me Vladimir Estene – Avocat – LEXION AVOCATS
Le contexte
Alors que le dispositif de complément de rémunération vise à soutenir la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable en assurant aux producteurs une rémunération raisonnable des capitaux investis, les récentes évolutions législatives n’ont eu de cesse de fragiliser ce dispositif, au détriment de la sécurité juridique dont ont pourtant besoin les acteurs du secteur pour investir sur notre territoire.
Avant d’en venir à l’analyse de la décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025, un bref rappel du cadre juridique applicable s’impose.
En application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie, les exploitants de certaines installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération obligatoirement conclu avec Électricité de France (EDF).
Les dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions prévoient le versement par EDF d’une prime aux producteurs lorsque le prix du marché auquel ils vendent leur production est inférieur au tarif de référence fixé par le contrat ou par arrêté.
A l’inverse, lorsque le tarif de référence est inférieur au prix du marché, le reversement à EDF par les producteurs du montant correspond à la différence entre ces deux prix, sous la forme d’une prime négative.
L’article R. 314-49 du code de l’énergie, dans sa rédaction initiale, prévoyait un plafonnement du reversement de la prime négative à hauteur du montant total des aides perçues depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération.
Dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité, le législateur a souhaité corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié certains producteurs bénéficiaires d’un soutien public.
L’objectif d’intérêt général poursuivi, in fine, était d’atténuer l’effet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final.
L’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 prévoyait ainsi que :
- de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2022, pour les contrats en cours qui intégraient un tel plafonnement, le reversement dû à EDF ne serait plus, dans certaines hypothèses, limité au montant total des aides perçues ;
- ce reversement serait calculé en fonction d’un prix seuil, déterminé, chaque année jusqu’à la fin du contrat, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget.
Par une décision n° 2023-1065 QPC du 26 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions précitées contraires à la Constitution, avec un effet immédiat à compter de la date de publication de la décision, en raison de l’incompétence négative du législateur : en s’abstenant de définir lui-même les critères de détermination de ce prix, le législateur a en effet méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit au maintien des conventions légalement conclues.
La décision
Faisant fi des conséquences logiques à tirer cette décision, qui l’invitait à définir les critères de détermination de ce prix, le législateur a privilégié l’établissement d’un dispositif de suppression pure et simple, et de manière rétroactive, du plafonnement des reversements dus par les producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable ayant conclu avec EDF certains contrats offrant un complément de rémunération.
Les conséquences financières de la déclaration d’inconstitutionnalité issue de la décision n° 2013-1065 QPC se trouvaient donc, implicitement mais nécessairement, couvertes par ce dispositif ayant l’apparence d’une loi de validation.
L’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit ainsi qu’à compter du 1 janvier 2022, les producteurs d’électricité dont les contrats en cours intégraient un tel plafonnement, sont tenus de reverser à EDF l’intégralité des sommes correspondant aux primes négatives.
Saisi par des sociétés productrices d’électricité (TTR Energy et Eolienne des tulipes) de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel est venu censurer les dispositions législatives portant sur le reversement des primes négatives.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a pris bien soin de préciser que, si le législateur a effectivement poursuivi un objectif d’intérêt général en prévoyant d’atténuer l’effet préjudiciable de cette hausse des prix de l’électricité pour le consommateur final, toutefois, il n’a pas pris les garanties suffisantes afin de limiter les atteintes au droit au maintien des conventions légalement conclues :
- « Au regard de cet objectif, le législateur était fondé à supprimer, de façon rétroactive, le plafonnement des primes négatives reversées par les producteurs au cours d’une telle période de forte hausse des prix de l’électricité, dès lors que leur était garantie, en application de l’article L. 314-20 du code de l’énergie, une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat.
- Toutefois, en dépit de cette garantie, les dispositions contestées ont pour effet de priver, jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat, les producteurs d’électricité de la totalité des gains de marché dont ils auraient dû bénéficier, une fois reversées les aides perçues au titre du complément de rémunération, dans tous les cas où le prix de marché est supérieur au tarif de référence, que ces gains découlent d’une hausse tendancielle des prix de l’électricité ou d’une hausse imprévisible liée à une crise énergétique.
- Dès lors, les dispositions contestées portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.
- Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution. »
Une abrogation à effet différé injustifiée et source d’incertitudes pour les producteurs
Alors que les requérants sollicitaient, à juste titre, que la déclaration d’inconstitutionnalité intervienne à la date de la publication de la décision commentée, le Conseil constitutionnel a décidé de prononcer une abrogation à effet différé, au 31 décembre 2025 :
- « En l’espèce, d’une part, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de permettre à de nombreux titulaires de contrats de complément de rémunération de contester le montant des reversements effectués à Électricité de France. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation des dispositions contestées.
- D’autre part, afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2025 dans les procédures dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. »
Dit autrement, les titulaires de contrats de complément de rémunération ne sont pas fondés, à date, à espérer pouvoir récupérer les reversements pourtant effectués à EDF sans base légale solide, afin vraisemblablement de ne pas obérer les finances d’EDF – et donc de l’Etat dans un cadre budgétaire déjà très contraint.
Une telle solution, si elle n’était pas suivie d’une nouvelle loi permettant de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité, serait particulièrement problématique.
Les producteurs sont contraints d’attendre que le législateur institue un dispositif rétroactif permettant de clarifier le sort des reversements effectués sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, sans quoi les sommes perçues par EDF ne pourraient pas être récupérées.
A cet égard, il est vraisemblable qu’un mécanisme reposant sur un prix seuil, tel qu’envisagé par feu l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, sera établi, les critères de détermination de ce prix devant alors être fixés par voie législative.
Par Me Vladimir Estene – Avocat – LEXION AVOCATS